Dans Rendre le monde indisponible (2020), le sociologue allemand Hartmut Rosa approfondit sa réflexion critique sur la modernité, amorcée dans ses précédents travaux, notamment Accélération et Résonance. À travers ce court essai percutant, Rosa propose une grille de lecture originale de notre époque, centrée sur le concept-clé d’« indisponibilité », qu’il oppose à l’obsession moderne de tout rendre contrôlable, prévisible et maîtrisable.
Le projet moderne de mise à disposition du monde
Depuis les Lumières, selon Rosa, les sociétés occidentales sont animées par un projet de fond : rendre le monde « disponible ». Cela signifie vouloir comprendre, maîtriser, contrôler et exploiter la nature, les objets, les processus, mais aussi les relations sociales et même soi-même. Ce que Max Weber nommait le « désenchantement du monde » s’inscrit dans cette logique : il ne s’agit plus de vivre dans un monde mystérieux et sacré, mais dans un monde qui doit obéir à la raison humaine.
Ce projet s’est accéléré avec la modernité industrielle et technologique. Rosa montre que la science, la technique, la bureaucratie, mais aussi l’économie et les modes de vie contemporains participent d’un même mouvement : réduire l’imprévisible, éliminer la contingence, garantir la sécurité, optimiser le rendement.
Mais cette volonté de mise à disposition se heurte à une contradiction profonde. Plus le monde devient disponible (via le numérique, les biotechnologies, l’intelligence artificielle, etc.), plus il perd sa capacité à nous toucher, à nous surprendre, à nous résister. Le monde devient lisse, plat, sans relief – il cesse d’être vivant.
L’importance de l’indisponibilité
C’est ici que Rosa introduit son concept central : l’indisponibilité. Il ne s’agit pas seulement de ce qui nous échappe ou nous résiste, mais de ce qui ne peut ni ne doit être entièrement domestiqué. L’indisponible, c’est ce qui garde une part d’altérité, ce qui échappe au contrôle sans pour autant être chaos ou hostilité. L’amour, la nature sauvage, la mort, le sacré, ou encore l’art véritable sont des expériences d’indisponibilité : on ne peut ni les planifier entièrement, ni les forcer à se produire à la demande.
Or, Rosa soutient que nous avons besoin d’indisponibilité pour vivre une relation de « résonance » avec le monde – un concept qu’il développe dans un autre ouvrage. La résonance désigne cette expérience de dialogue vivant entre le moi et le monde, quand quelque chose nous parle, nous transforme, sans que nous puissions le prédire ou le provoquer à volonté. Elle exige que le monde garde une part de mystère, de distance, voire d’inaccessibilité.
Une critique du monde contemporain
Dans Rendre le monde indisponible, Rosa ne propose pas simplement une critique nostalgique de la modernité. Il invite à repenser nos priorités collectives. L’obsession du contrôle et de l’optimisation (notamment dans la gestion technocratique, la planification économique, les politiques sécuritaires ou la gestion des risques) conduit à une perte de sens, à une fatigue sociale, voire à une forme d’hostilité envers le monde. Cela se traduit, par exemple, dans la crise écologique : en cherchant à dominer la nature, nous détruisons ce qui nous rendait vivants avec elle.
Rosa appelle donc à une « culture de l’indisponibilité », où l’on reconnaîtrait la valeur de ce qui échappe, résiste ou transforme sans être maîtrisé. Cela implique de réhabiliter des formes de lenteur, de silence, de respect du vivant, mais aussi de repenser l’éducation, la science ou l’économie dans une perspective relationnelle, plutôt que purement fonctionnelle.
Un manifeste pour une autre modernité
En moins de 100 pages, Hartmut Rosa propose un essai à la fois dense et accessible, qui résonne avec de nombreuses préoccupations contemporaines : écologiques, existentielles, philosophiques. Rendre le monde indisponible n’est pas une condamnation de la modernité, mais une tentative de la réorienter. Il s’agit de construire un monde où l’on puisse encore être touché, transformé, surpris – bref, un monde dans lequel il vaille la peine de vivre.
Sources
Article généré par IA (Chatgpt)
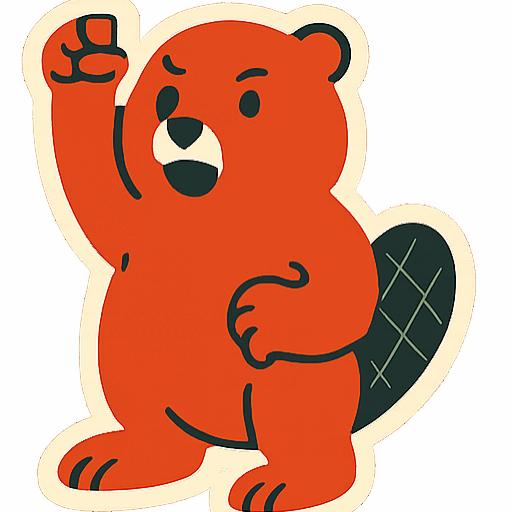
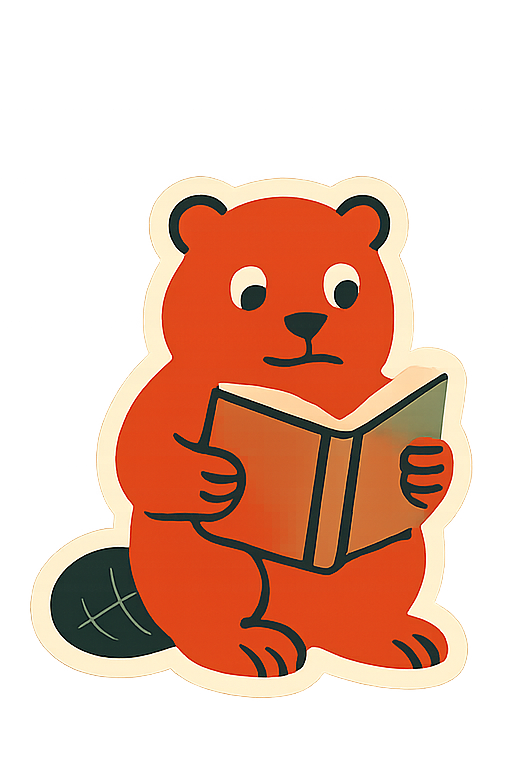
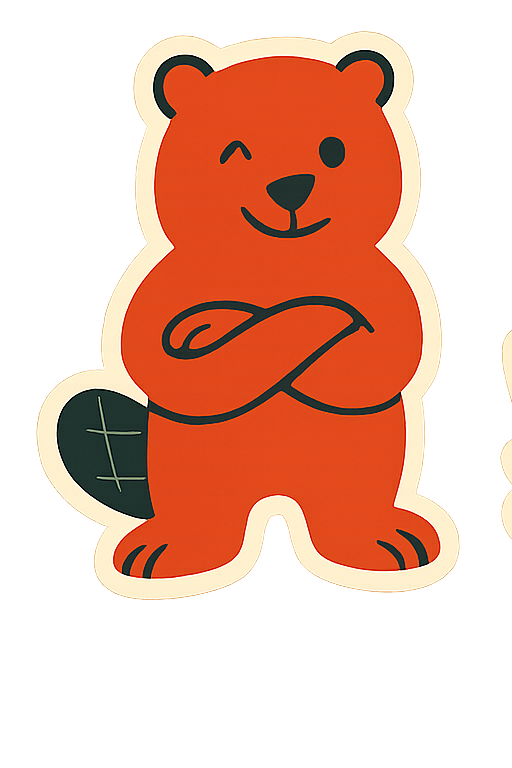
0 commentaires